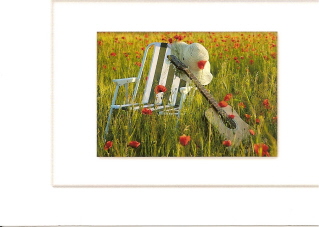1
Ma mère a toujours eu de hauts désirs pour moi. Elle me lançait régulièrement des défis insurmontables, des challenges terrifiants. Elle projetait sur moi des intentions de succès qu’elle n’avait pas obtenus.
En juillet mille neuf soixante-seize – j’étais alors à peine âgée de cinq ans -, elle décida de me faire pratiquer de manière assidue la natation.
J’avais appris doucement à nager dans la mer de Méditerranée, en juin, lors de mes vacances à Cavalaire. J’avais apprivoisé sans peur le bercement des vagues qui montaient jusqu’à mes épaules, accrochée à un canard rieur et multicolore.
Les cours de natation avaient lieu tous les jours, de neuf heures à douze heures, excepté le dimanche.
Après avoir joué avec mes poupées dans la bonne herbe ensoleillée et odorante, je voyais avec angoisse le soleil se coucher derrière la colline et répandre sa liqueur d’or sur le jardin. Mon ventre se serrait. Déjà le soir ; déjà le lendemain matin…
Sortir de force de l’eau si tendre et sécurisante du sommeil était pour moi un arrachement. Je mangeais à peine au petit déjeuner. Il ne fallait pas que mon estomac fût trop chargé pour la nage. Je buvais à petites gorgées du lait chocolaté que j’avais envie de rendre immédiatement.
Ensuite, départ pour la piscine olympique. La route qui serpente la forêt non loin de la ville minière, puis le bâtiment aux larges baies grises.
Dès l’entrée, la forte odeur d’eau de Javel m’écoeure. Le trac monte de mon ventre à mon coeur. Dans les vestiaires rouges, il faut affronter le froid, le sol mouillé et glissant, les sandales de caoutchouc qui claquent, la porte du placard métallique comme un coffre-fort, le serpent plastifié qui entoure mon poignet.
Puis, devant moi, l’eau d’un bleu acide et profond.
Tous les matins, je me réveille pour mourir.
2
Lors du premier cours, le maître-nageur juge bon d’accélérer la familiarisation avec l’eau en enfonçant la tête de chacun des élèves en cercle autour de lui. Il le fait d’un geste sec, désinvolte et rapide, comme si c’était un jeu pour lui.
J’ai à peine le temps de voir le fond de la piscine, les larges traits noirs qui courent sur toute la longueur du bassin dans cette eau chlorée et transpercée de bleu qui envahit brusquement mon menton, mes lèvres, entre dans mon nez et mes yeux. Je respire ce liquide sauvage. Je me noie, du moins je le crois. Quand je sors mon visage, je suis aveugle. Mes yeux me brûlent ; une toux opiniâtre secoue ma poitrine ; mon coeur bat fort.
Où suis-je ?
Ou plutôt qui suis-je ?
Je ne suis plus que challenge, compétition, effort. Je dois faire à tout prix ce qu’on attend de moi.
De séance en séance, je m’entraîne à la brasse, au crawl, au papillon. Bien que cette nage porte un nom léger et libre comme les papillons d’or que je vois tournoyer dans l’été, elle est lourde, violente, exigeante. Tous les muscles de mon corps sont mobilisés. Le soir, je m’endors, fourbue.
J’attends avec impatience le dimanche suivant qui me semble toujours si loin. Je traverse les distances, m’essouffle, m’enfonce, réapparais et recommence. Du haut des gradins, ma mère me regarde tout en discutant avec une amie dont elle a fait connaissance sur les lieux.
Moi, si petite et si frêle, je dompte l’élément. J’exécute si docilement les ordres que je suis bientôt à niveau, prête pour le haut plongeoir.
3
Je suis debout, tout là-haut, tout au bout de la planche de bois.
En bas, l’eau m’attend, impassible, ondulant sournoisement dans son indifférence bleue.
Je mesure la distance qui me sépare de cette mort.
Auparavant, j’ai monté en tremblant les marches de l’échelle comme celles d’un échafaud. Le nombre d’élèves avant moi me laisse un peu de répit.
Ce n’est pas encore à moi… Ce n’est pas encore à moi… N’aie pas peur… Tu as encore le temps… Il y en a dix devant toi… Puis cinq… Puis deux… Puis un… Puis toi…
Je tremble de froid et de peur. Mon maillot de bain est trempé. Je croise les bras sur mon ventre.
Je regarde autour de moi. Les autres sont passés. Ils ont vaincu. Ils nagent maintenant, tranquillement, dans la gloire de la lumière de cette fin de matinée qui traverse les baies. En haut des gradins, ma mère me regarde, sa copine me regarde. Je pense que sur ce plongeoir, face à ce bassin immense, je suis une simple baguette dirigée par un chef d’orchestre.
En bas, le maître-nageur tient sa perche droite et me crie :
-Mais saute ! Saute donc ! Qu’est-ce que tu attends, Gégé ?
4
Le gouffre noir.
Ai-je sauté ? Plus moyen de me souvenir.
Pendant longtemps, j’en ai discuté avec une amie.
Je crois que j’ai sauté. Je ressens encore l’impulsion qui me guide vers l’abandon, le vertige qui creuse mon ventre. Je vois le plafond et les gradins qui se renversent.
J’entends mon cri, peut-être, le claquement violent de l’eau contre mes tympans. J’éprouve le poignard du froid, la douleur autour de mes reins et la brûlure du chlore dans ma gorge et mon nez comme la toute première fois.
Je me revois remonter à la surface. Nager, effectuer la longueur du retour en n’écoutant que mon souffle. Cette obsession de la respiration qui habite tout nageur… je la connais.
Mais je crois tout autant que je n’ai pas sauté. Je me vois faire demi-tour, quitter les regards pour leur faire face à nouveau lors de ma descente de l’échelle. Je ressens la froideur des barreaux. Je revois le regard furieux du maître-nageur, la mine désappointée de ma mère, le visage moqueur de l’amie. J’entends les quolibets des camarades :
-Ouh ! La lâcheuse ! Ouh ! La trouillarde !
Je retourne probablement au vestiaire. Je grelotte. Je m’essuie vigoureusement. Les cheveux encore mouillés, je retrouve ma mère. J’ai été exclue de la piscine olympique. Le courage prend souvent l’apparence de la lâcheté.
Ai-je sauté ?
5
Trente ans plus tard, après mon échec à l’admission de l’agrégation (admissible, j’ai été recalée de peu mais être recalée de peu n’est pas un honneur, c’est être recalé. Point. J’ai tellement déçu ma mère !), alors que je feuilletais des livres au Rayon Développement Personnel, j’ai entendu cette voix intérieure, très profonde, comme une certitude :
-Tu le sais ? Tu as sauté ! Bien sûr que tu as sauté !
6
J’ai renoué avec l’eau. Je joue avec elle. J’aime ses métamorphoses, ses reflets, ses lumières qui ondoient autour de moi. Je ne l’affronte pas. Je me laisse porter par elle.
Je m’en enveloppe comme d’une robe qui épouse parfaitement mon corps.
Quand je le veux, je mets ma tête dans l’eau très doucement pour sentir sa caresse monter de ma nuque à mes cheveux.
Lorsqu’on renonce à la dompter, l’eau est d’une tendresse débordante.
C’est surtout dans la mer Méditerranée que je redeviens une enfant pleinement acceptée. A nouveau née, non loin de la terre. En sécurité.
Je n’ai plus jamais plongé.
Je préfère offrir mon visage au ciel.
Géraldine
Andrée
Partagez en toute complicité !