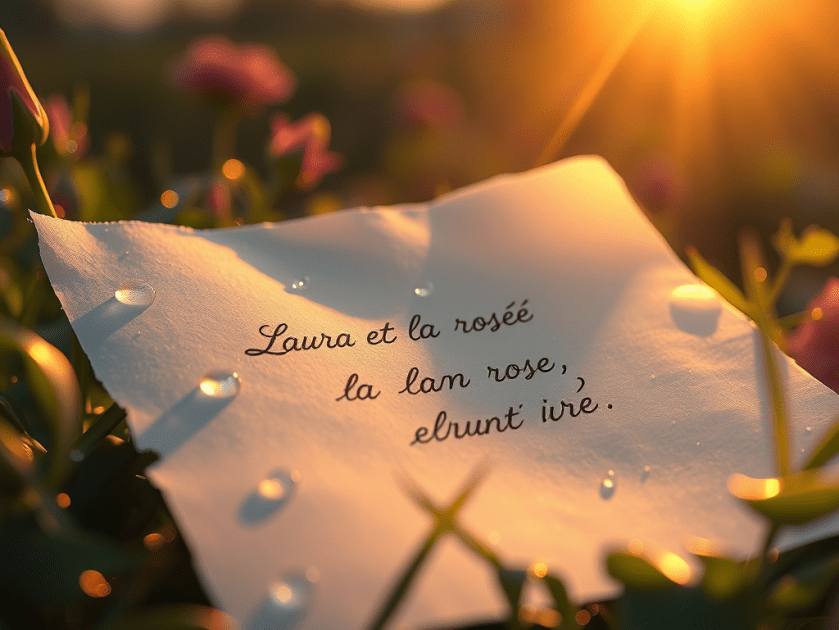
Laura m’a dit que l’écriture venait de la rosée.
Mais lorsque les premiers mots brillent à l’aube
Sur la feuille devant moi,
Je crois
Que la rosée
Vient de l’écriture.
Géraldine Andrée
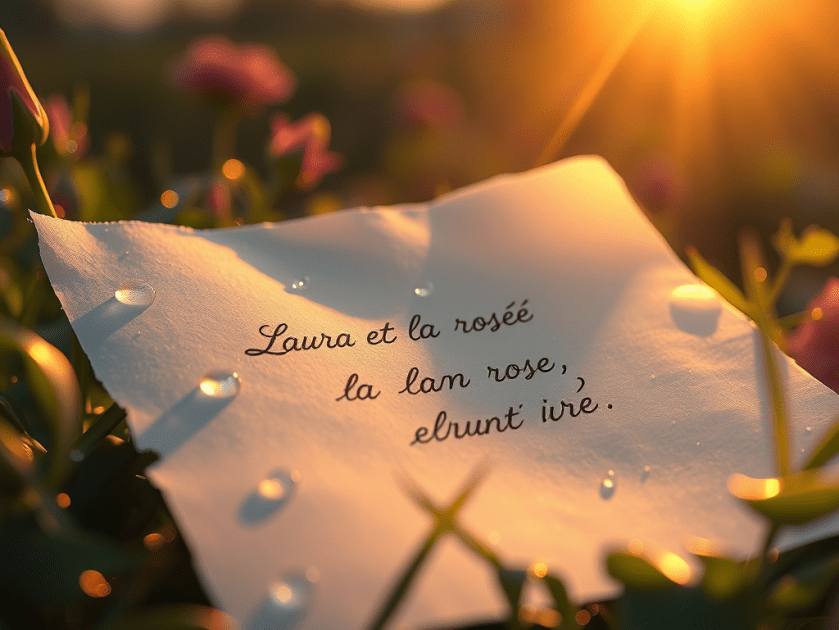
Laura m’a dit que l’écriture venait de la rosée.
Mais lorsque les premiers mots brillent à l’aube
Sur la feuille devant moi,
Je crois
Que la rosée
Vient de l’écriture.
Géraldine Andrée
Recommence
Donne-toi encore une chance
Recommence sur une feuille vierge
même au milieu du carnet
Taille la pointe de ton crayon
Dessine une majuscule
rien qu’une
puis dépose le premier mot
parmi les copeaux
Et s’entrouvre le chemin
parsemé de minuscules brindilles
qui crépitent
comme de petites flammes
nouvellement nées
N’attends pas un quelconque signe du destin
une approbation du voisin
une amélioration du monde
Tourne la page
gâchée inachevée ou trop remplie
Fais de ce matin
toute une vie
Fais de l’endroit où tu es
à l’angle d’une table
entre les miettes
ton lieu unique
celui qui te permettra d’advenir
car n’oublie pas
l’eau ensemence la terre
par les moindres interstices
Recommence
Tôt ou tard
il est toujours temps
il n’y a pas d’âge
pour rencontrer ton sourire
qui t’attend
de l’autre côté
La carte que tu as tirée
est bien la bonne
Alors recommence
Géraldine
Je digère le seuil de la chambre de jadis
Je digère le tapis de Perse
qui ne gardera pas trace de mon retour
Je digère la couverture fleurie
Je digère les ombres qui envahissent la fenêtre
Je digère la petite table d’acajou
Je digère la chaise d’osier haute comme trois pommes
Je digère la lampe au rayon roux
Je digère le miroir qui me reconnaît si je lui souris
Je digère le papillon de ma barrette
Je digère la montre que papa m’a offerte – corolle d’or du temps qu’il me reste
Je digère deux feuilles épaisses
Je digère les mots qui ont mariné dans leur encre onctueuse
et j’en laisse quelques miettes
à l’oiseau du silence
qui m’épie
avec envie
J’avais tellement faim
que dans ma boulimie de poésie
j’ai avalé la moindre lettre
vilaine ogresse
de mes rêves
qui prennent chair
sur le papier
Maintenant
mon cahier
est une assiette blanche
que je ne peux m’autoriser
à lécher
parce qu’on m’a dit
que c’était impoli
même si je suis
ma seule invitée
Alors je dresse la table
pour demain
Je place un autre cahier
tout au centre
à gauche un crayon de papier
à droite mon stylo plume brun
d’où sourd toujours une goutte noire
et en face
un encrier
pour la soif
si jamais mes larmes
sont un tantinet
trop salées
©Géraldine Andrée

La nuit, tu peux partir loin,
loin des régiments, des règlements, des jugements.
La nuit est en elle-même
un voyage.
Souviens-toi.
Oui.
La route dans la nuit.
De part et d’autre,
le sable brillant
comme du mica sous la lune,
des points d’herbe jaunie
que désignent
les yeux des étoiles.
Visions fugaces,
si vite évanouies
mais que tu gardes sur la rétine,
tel un signe
qui te guide.
Et dans tout l’habitacle,
la playlist d’Enya
– Celts, Aniron, Paint the sky with stars -,
infinie.
Combien de temps durera le voyage ?
Comment savoir ?
Le temps ne signifie rien,
car seul importe ce fragment de route
qu’éclairent les phares,
pour cette seconde,
cet instant
seulement.
Tu ne vois la route qu’en la traçant.
La destination ?
On verra plus tard.
Voici le ruban du voyage,
déroulé d’une lueur
à un accord,
d’une note
à un silence,
avant que le morceau
ne reprenne
sur la plage trois.
La nuit est un temps
dans l’espace,
un espace
dans le temps.
Nous arrivons à la baie
quand
l’aurore se répand
dans le ciel
comme un encrier
d’enfant.
Perclus de fatigue,
ivres de route,
d’inconnu,
de musique.
Étourdis par le ronronnement
du moteur
qui s’arrête soudain.
Perdus,
un peu étonnés
d’être au bon endroit.
Figés
dans un vertige
qui continue
à nous faire
tanguer
à travers
sa spirale.
Chancelants
comme si nous nous trouvions
au bord du vide.
Devant nous,
la marina,
immense
corolle blanche
épanouie
sur la taie
de l’azur.
La visière
de nos mains
sur nos paupières,
éblouis
par le dard du soleil
déjà vif,
nous croyons rêver
ce paysage.
Mais la mer est bel
et bien là,
bordée
de part et d’autre
de terrasses blanches,
dans le silence
translucide
du ciel.
Et notre voyage de nuit ?
Il n’est plus qu’une ligne temporelle
qui tremble
et qui s’efface
au loin.
Peut-être est-ce depuis
ce long voyage
que j’ai pris l’habitude
d’écrire de nuit.
Parce que je sais,
seule, à bord
de mon cahier d’or
qu’un mot,
parfois,
me sépare
de l’infini.
Géraldine Andrée
Pour l’écoute du poème, c’est Ici !

Et pour acquérir mon livre édité par Advixo, en e-book et en broché, c’est ici !
Moi – Maman, où as-tu mis les souvenirs ?
Moi – Mais tu sais bien ! Ceux de l’enfance, enfin !
Elle – Prends une bêche dans les dépendances et creuse la terre du jardin.
Moi – Il n’y a rien ! Que des fouillis d’insectes…
Elle – Alors, prends l’échelle et monte dans les feuilles du mirabellier… Tu n’as pas besoin de moi.
Moi – Il n’y a que des nids vides.
Elle – Va plus haut ! Plus loin !
Moi – Mais je vais bouleverser l’ordre des étoiles…
Elle – Alors, reviens ici et fouille l’armoire.
Moi – Que du noir. Et le tissu mité de l’amour.
Elle – As-tu pensé à la corbeille d’osier dans la véranda ?
Moi – Là où tu entreposes les pamplemousses du soleil ?
Elle – Oui. C’est là.
Moi – Je me suis piquée avec les pointes de l’osier troué.
Elle – Quelle mijaurée ! Utilise tes ongles donc, pour gratter l’écorce de l’oubli.
Moi – Je vais y laisser ma peau. Il me faudra trente lunes pour cicatriser.
Elle – Déclenche le disjoncteur.
Moi – C’est fait. Pas le moindre éclairage dans le cœur.
Elle – Et ce sentier entre la fenêtre et les feuillets bleus ? Y es-tu allée ?
Moi – Je vais essayer.
Elle – Je suis sûre qu’il mène à la maison aux poèmes !
Moi – Celle en faïence, avec des femmes en éventail dessinées sur les murs ?
Elle – Oui, c’est là que nous allions nous reposer en été.
Moi – J’ai bien ouvert la porte. Je n’avais pas la clé. Alors, j’ai utilisé celle de secours, que j’avais cachée au fond de moi, en pensant : On ne sait jamais…
Elle – Bien ! Tu vois, tu arrives à te débrouiller seule…
Moi – Et sais-tu ce que j’ai trouvé ?
Elle – Non.
Moi – Toutes ces lettres que je ne t’ai jamais envoyées.
Elle – Et elles disent quoi, ces lettres, s’il te plaît ?
Moi – Les remords, les regrets, les absences, les silences, les actes manqués, quelques moments de connivence,
et l’attente
que tu changes,
que je change
si tu changes.
Rien de ce que j’ai écrit,
rien de ce que j’ai déploré, espéré,
n’a cheminé jusqu’à toi.
L’écriture n’a rien changé !
Elle – Tout a été accompli, au contraire !
Moi – C’est-à-dire ?
Elle – C’est toi seule, notre histoire.
Ne me cherche plus puisque je suis partie.
Écris, écris seulement
pour tresser l’osier
de la corbeille
de ma mémoire.
Géraldine Andrée
Où s’en est allée la rosée
sur les feuilles de menthe
Je cherche ses points
depuis ce matin
et je me demande
si je ne l’ai pas rêvée
comme autrefois
quand j’emportais
des étoiles
en me rendormant
Reviens
reviens vers ton regard
derrière la taie
de tes paupières
retrouve le premier
émerveillement
de l’enfant
qui rentre à la maison
avec sa corbeille de prunes
cueillies
en catimini
quand tout le monde
sommeille
encore
Reviens à cette solitude
qui te murmure
Souviens-toi
Tu écris de la poésie
parce que tu n’es pas de ce monde
Reviens vers les voix
qui s’entrelacent
tissent leurs nids
pour que tu puisses
y trouver
refuge
dans l’exil
Reviens au premier mot
du jour
ce nombril
relié
au cordon de
l’encre
dans lequel
tu entends
la pulsation
du temps
Reviens
à la veine
du poème
qu’irrigue
ton sang
Reviens
à ce bourgeon
qui vibre
palpite
annonce
la fleur
sans qu’aucune
prophétie
soit nécessaire
La rosée
effacée
est toujours
présente
dans la lumière
qui déploie
sa voilure
sur la terre
Fais crépiter
le papier
comme ces branches
que le bras du promeneur
écarte
Humecte ta bouche
La rosée point
dans la salive
d’un mot
d’encouragement
que tu prononces
en traçant un sentier
pour ce vers
qui traverse
seul
pieds nus
la page
déserte
Remonte
à la source
qui est partout
y compris
chez toi
dans le cri
de ta gorge
qui jaillit
sur le blanc
et qui multiplie
ses gouttes
de silence
en silence
La source est surtout
en toi
Écris
écris encore
comme on frappe
des pierres
entre elles
jusqu’à l’étincelle
qui t’arrachera
des larmes
de joie
Récite
alors
à voix haute
l’histoire que tu avais confiée
à la nuit
jusqu’à ce que la sève
remonte
dans ton corps
explose
sur ta bouche
Sens-toi devenir
tige
vertige
déplie-toi
dans l’attente
du jour
Il y aura toujours
un poème
une constellation
dans le jardin
de tes mains
si tu le veux bien
Tu es toi-même
ce point de rosée
sur lequel se penche
l’enfant
qui n’aura pas oublié
son rêve
tant que tu écriras
à l’aube
Géraldine Andrée
Écrire, c’est
Écrire surtout pour ne pas relire, ni donner à lire.
Parce que cela équivaudrait à arriver, et donc à mourir.
Écrire pour être.
Écrire pour être enfin délivré
du besoin d’exister.
Géraldine Andrée
J’ai poussé le portail comme autrefois, quand je rentrais de l’école. Et je ne me suis plus sentie la même.
Les lieux avaient-ils à ce point changé ?
Partout, de l’herbe folle, des ronces, des chardons, et ces orties dont les piqûres incendiaient mes nuits. Partout, des arbustes non taillés « depuis des lustres », comme aurait dit mon père.
J’avais passé de si nombreuses années à désherber mes pensées, à défricher mes émotions avant de déchiffrer le sens de ma vie. J’avais coupé tant de racines, arraché les tiges de tant de projets stériles, déterré le chiendent de tant de vieux chagrins avant de tracer mon chemin.
Aussi ne me suis-je pas reconnue dans ce jardin. Et le jardin, lui non plus, ne m’a pas reconnue.
Il était à l’envers dans ce désordre de verts et moi, je me retrouvais, certes, à l’endroit,
mais pas au bon endroit.
Ce sentiment d’étrangeté m’a enveloppée comme un manteau glacé, après que j’ai franchi le seuil de la maison.
L’écho de mes pas me renvoyait à cette fille qui n’était plus, que je n’étais plus. Tandis que les aiguilles de mes talons martelaient le sol du corridor, je m’éloignais de l’ancienne enfant qui avait vécu ici, dans ces pièces aujourd’hui dépouillées, vidées, dégarnies.
Les fleurs de la tapisserie de ma chambre avaient jauni sans se refermer. L’automne durerait à vie.
Je passais d’une pièce à l’autre, comme si je feuilletais des pages où plus rien ne s’écrirait. Et toujours cette épineuse question :
Passais-je de moi à l’autre, de l’autre à moi ?
Dans le salon sans miroir, un carton gisait, à moitié ouvert. Que d’images défraîchies, de rêves dépassés, de journaux intimes désuets dont l’écriture tourmentée de jouvencelle témoignait du fait que je n’écrirais plus ainsi… Celle qui s’était épanchée dans ces feuillets était la fille à qui j’avais cessé de ressembler, une bonne fois pour toutes, même si ma signature, elle, n’avait guère changé. Frêles pattes de coccinelle que les lettres de mon prénom qui s’avançaient sur une ligne presque effacée. C’était la seule preuve de mon identité.
Et cette sempiternelle question :
Était-ce moi qui ne reconnaissais plus l’enfant ?
Ou était-ce l’enfant qui ne me reconnaissait plus ?
Avais-je à ce point grandi ? Il me semblait, en parcourant ces cahiers, que je contemplais un autre visage dans leur miroir de papier. Tant d’autres pièces à explorer s’étaient ouvertes dans mon regard. Chambres de désirs, d’amours, de passions inextinguibles.
Je n’avais rien hérité de la vie de mes aïeux dans ce lieu mais je possédais un merveilleux trésor : la certitude que j’avais une vie à poursuivre. J’étais devenue la gardienne de la chambre de mon cœur.
J’ai tout balayé du regard.
Il fallait partir.
Définitivement.
Ma maison était désormais ailleurs.
Ma maison pouvait se démultiplier à l’infini. Dans une chambre en Italie, dans une grotte en bord de mer, dans un café illuminé au milieu de l’hiver. Dans des poèmes aussi. Et dans mes livres favoris. Dans Writing to the bones de Natalie Goldberg. Ce livre sur l’écriture. Car il n’existe pas, à mes yeux, de meilleure forme de pérennité que d’écrire sur l’écriture.
On écrit, selon Natalie, comme on fait son deuil.
On écrit comme on franchit un seuil.
Parce que l’on tourne la page.
On écrit comme on vit.
En allant toujours de l’avant.
Vers l’inconnu. Vers le blanc.
De page en page.
À remplir. À meubler. À décorer. À habiter.
Écrire, c’est passer d’un espace à l’autre.
Écrire, c’est devenir une autre.
Écrire, c’est aller plus loin,
de l’autre côté,
au-delà,
là-bas.
Écrire, c’est passer.
C’est trépasser.
Pour renaître au cœur d’autres maisons, d’autres cahiers.
Natalie dit que l’on ne devient écrivain que si l’on accepte de dire adieu à tout ce qui est et qui, à partir du moment où l’on en prend conscience, n’est déjà plus.
Le présent est à chaque instant dépassé.
Écrire, c’est explorer toutes les manières de dire adieu.
Noter dans la marge, puis oublier, comme on quitte la silhouette familière sur le bord d’un quai.
Résumer. Figer dans un sommaire. Annexer.
Pour partir l’esprit libre.
Écrire parce que l’on n’espère plus de retrouvailles.
Alors, on laisse reposer les vivants comme les morts sur un lit de papier.
Écrire parce que l’on ne croit pas aux apparitions.
Écrire parce que tout ce qui importe, c’est la circulation de l’encre. Et pour que l’encre circule, il faut se permettre de vivre d’autres histoires.
Chaque souffle de notre vie est unique. Comme est unique chaque lettre que nous traçons durant la longue phrase du périple de notre existence. Il n’y en a pas une qui ressemble à l’autre. Chaque trait de plume possède sa propre vibration, imperceptible et néanmoins si présente, si palpitante. Chaque boucle est une aile qui s’apprête à se déployer de manière différente.
Alors, j’ai trouvé l’art et la manière de tirer un trait sur celle que je fus.
Je montre à la petite fille sa place dans ma chambre intérieure.
Je lui dis : « Assieds-toi, ma fille ! »
Je lui donne des feutres de couleur et je la laisse libre de dessiner son jardin avec toutes les herbes folles, tous les chardons argentés, toutes les orties bleues qu’elle veut. Je l’autorise à se cacher dans cette végétation brouillonne, à disparaître derrière une haie débordante de feuilles si elle le souhaite, tandis que je note en titre :
Une chambre en Italie.
Avec quelques mots, je brode une fleur rose sur le drap blanc.
Quelques pétales, c’est bien suffisant.
Nouvelle pièce.
Nouvelle page.
La future amoureuse et moi, nous nous attendons mutuellement.
Géraldine Andrée
Elle a rêvé d’une grande
page blanche
sur laquelle le jardin
de son enfance
jadis vendu
puis détruit
lui était rendu
dessiné
par sa main
de petite fille
Voici le chemin
qui sautille
dans un rayon
de soleil
roux
de brindille
en caillou
les feuilles
de frêne
repliées
pour que s’y faufile
le souffle
de ses lèvres
et dans la prunelle
d’une lettre ronde
l’œil du chat
qui cligne
Et elle se demande
si ce n’est pas elle
qui s’est effacée
pendant toutes
ces années
car elle voit là-bas
près du mur
qui sépare le jardin
du monde
le pommier lui tendre
des pommes
bien mûres
bien blondes
bien charnues
comme
en ces matins
de septembre
quand elle en cueillait une
avant de se rendre
à l’école
Pressée par le temps
elle a dissipé cette vision
elle s’est habillée
puis elle est sortie
dans les rumeurs
et les lumières
convulsives
de la ville
À midi
elle n’avait même
plus souvenance
d’avoir rêvé du jardin
de son enfance
dans la nuit
Ce n’est que le soir
une fois assise
sous le rayon roux
de la lampe
que le rêve lui est revenu
sur la taie blanche
de son regard
retenu
immobile
par un point
invisible
dans l’ombre
de sa chambre
Il y a là-bas
le chemin
du jardin
de jadis
qui glisse
de caillou
en brindille
et qui la mène
à une feuille
qu’elle déplie
pour que les mots
rejoignent
ses lèvres
Le jardin
lui est rendu
dans un poème
qu’elle écrit
avec une encre
qui brille
pour ses yeux
de petite fille
cachée
par malice
et sous lequel
elle signe
en lettres cursives
le prénom
Géraldine
Géraldine Andrée
Choses qui ne durent qu’une saison :
des sandales et une robe d’adolescente, un chapeau de paille, un magazine acheté au kiosque de la plage, une pivoine, un amour de vacances…
Tout se défait, se froisse, s’effiloche, se dégrafe, se flétrit, se déchire.
Il n’y a qu’une chose chère à ton âme qui dure peut-être une éternité :
ce poème que tu écris en larmes
en souvenir de l’amant que tu ne reverras plus,
et qui a pourtant cueilli en toi
la corolle du lilas ;
ce poème que tu composes
pour toi seule
dans ton carnet blanc
et que tu entoures
d’une treille de roses,
tandis que tes parents ferment
les volets de la villa
pour une année entière ;
ce poème dont la feuille
éclairera ta chambre
lorsque tu ouvriras la porte
sur les vacances suivantes
– comme une étoile morte
depuis longtemps.
Géraldine Andrée
