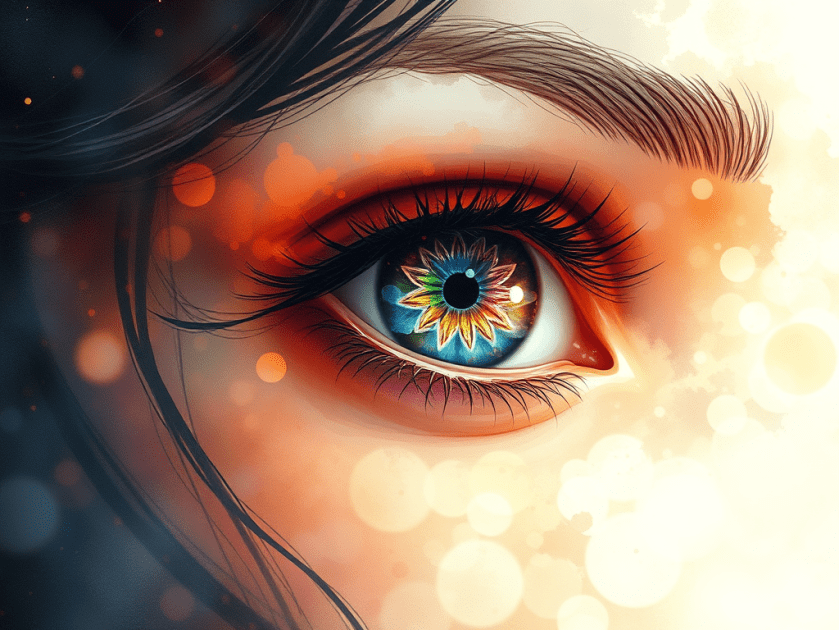Adolescente, j’avais une vaste chambre et une grande table sur laquelle je pouvais ouvrir plusieurs cahiers – ceux de mes leçons et de mes devoirs du jour, à côté de mon journal intime et de mon cahier de contes secrets. Je revois ma trousse profonde contenant tous mes stylos et feutres de couleur. Je possédais même une plume à tremper dans un encrier.
Vous pourriez me dire :
« Comme tu étais gâtée ! »
Et je vous comprends. Il ne me manquait rien. Ma chambre donnant sur un jardin, je disposais de tout l’espace pour étudier.
Ce que j’ignorais, c’est que j’avais également un autre espace de création, très important, et qui était régulièrement bafoué :
mon espace intérieur,
vous savez,
celui de l’âme, celui du cœur,
d’où jaillissent les rêves les plus féconds,
d’où naissent les désirs qui nous nourrissent.
Cet espace de trésors, j’en méconnaissais l’existence, le territoire, malgré mes voyages sur le papier ligné.
Pourquoi ?
Parce que mes parents et ma sœur pouvaient entrer comme ils voulaient, sans frapper.
Ils se permettaient d’ouvrir mes tiroirs. Un jour, ce fut l’esclandre, parce qu’ils avaient trouvé une boîte de pilules contraceptives.
Mon père surgissait pour m’empêcher d’écrire mes histoires personnelles qu’il nommait « fariboles ». Il craignait sans doute que mes fées, mes elfes et mes lutins n’éclairent une part d’ombre merveilleuse en lui qu’il voulait garder cachée à ses propres yeux.
J’ai acheté un cahier qui se fermait avec une clé dorée. Au moins cet endroit qui matérialisait mon espace psychique était-il protégé.
Mais un dérangement imprévisible était toujours possible, détournant le cours d’une idée, la rivière d’un poème, la source elle-même.
Cette négation de l’existence de mon espace de création intérieur m’a bloquée dans beaucoup de projets.
Je me souviens comment, dans la résidence universitaire où je logeais, une pseudo amie s’épanchait sur ses peines de cœur chaque soir, à demi couchée sur mon lit, m’empêchant de régler les miennes dans mon carnet ou de rendre cette dissertation urgente pour le lendemain.
Aujourd’hui, je ne résiste pas au vieux réflexe d’aménager mon espace de création extérieur pour créer.
Comme pour me préserver des éventuels importuns.
Allumer une bougie, faire la vaisselle, la lessive, chercher LE stylo du moment… Tout doit être propre et net pour démarrer ma séance d’écriture.
Je sais pertinemment que je procrastine et que je perds, en agissant ainsi, de précieuses minutes pour continuer à écrire quelques lignes de plus, alors que je suis déjà si pressée.
Mon amie Julia me l’a si souvent dit :
« Saisis un vieux stylo Bic, bon sang, un cahier de brouillon tout taché, et écris, même au milieu des miettes de croissant, des gouttes de Nutella, à côté de ta tasse de café froid. Pas besoin d’encens, de lampe tamisée. »
J’ai déjà eu l’occasion de le constater : je peux commencer à écrire dans un espace encombré et avoir les idées claires, démarrer un projet de roman tandis que la poêle à crêpes reste dans l’évier et trouver mon œuvre aboutie, réussie – in fine,
car toute création part de l’espace intérieur.
Et si je ne m’autorise pas à privilégier mon intériorité créatrice, qu’advient-il des mots en attente ? Ceux-ci continuent à patienter. Désespérément pour eux et pour moi.
Nul besoin d’une vie en ordre pour dérouler la trame de cette broderie qu’est le texte qui demande à voir le jour.
Un marteau-piqueur peut tonitruer dans l’espace de création extérieur… Tant que vos projets ne sont pas dérobés dans la chambre de votre cœur par ce que je nomme aujourd’hui « une intrusion » ou une « interférence », vous êtes en sécurité dans la vie que vous donnez à votre rêve, pour qu’il naisse, un jour, sur l’immense table du monde.
Géraldine Andrée